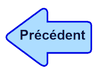Mauritanie 1987 - 1990
1987 Un accord sur la pêche entre la CEE et la Mauritanie
Cet accord, attendu depuis 1979, se substitue aux divers accords privés précédents. Il est signé pour les 3 années à venir et entre en vigueur le 1er juillet 1987. Bien accueilli au début par les pêcheurs et armateurs, il permet d'avoir une vision plus stable de l'avenir des langoustiers.
Le contenu de l'accord de 1987 :
L'accord est conclu pour 3 ans, renouvelable.
Le prix des licences est allégé grâce à une compensation de la CEE.
Chaque navire doit embarquer 35 % de marins mauritaniens (3 matelots).
Obligation de déclarer les captures.
Le nombre de navires autorisés à pêcher la langouste rose est fixé par un quota de 3 500 tjb par mois, partagé entre Français (2 627 tjb) et Portugais (873 tjb), ces derniers ayant perdu leurs droits de pêche démersale.
Une vision plus stable de l'avenir des langoustiers
Les armateurs prévoient déjà de nouveaux investissements. En juin 1987, L.Y. Dhellemmes rachète la compagnie France-Langouste (les 5 langoustiers douarnenistes) et prévoit la construction de nouveaux bateaux. À cette même époque le mareyeur Furic investit et devient majoritaire dans le Portzic.
Le fait nouveau et inquiétant est l'augmentation du nombre de bateaux autorisés à prélever la langouste rose du banc d'Arguin.
La répartition des tonnages autorisés est de 2 627 tjb pour les Français ce qui représente en gros 10 à 11 bateaux de la taille de l'Armorique., et 873 tjb pour les Portugais, correspondant au tonnage de 8 fileyeurs d'environ 100 tjb.
Les armateurs prévoient déjà de nouveaux investissements.

(Photo Bertrand Palud)
Pourquoi les Portugais ?
Depuis 1984 le Portugal a un accord de pêche avec la Mauritanie concernant des chalutiers et des fileyeurs. En 1987 ils perdent leurs droits. En compensation, ils reçoivent de la CEE des licences pour la pêche de la langouste rose aux casiers. La plupart de ces bateaux étant des fileyeurs, ils obtiennent une dérogation d'un an pour passer du filet maillant à la pêche aux casiers.
Des tensions entre Portugais et Bretons
Rapidement la tension monte entre Finistériens et Portugais. Ces derniers, nouveaux venus à la pêche langoustière, envahissent les zones de pêche des Bretons et posent des kilomètres de filets qui s'emmêlent aux casiers. Les deux pêches ne sont pas compatibles, du moins sur une même zone.
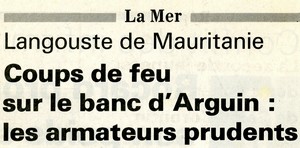
En juillet 1988, à la fin de leur dérogation, les Portugais continuent la pêche au filet. Ils sont dans l'illégalité mais il n'y a pas d'arbitre, les autorités mauritaniennes laissent faire et la CEE ne peut intervenir dans les eaux mauritaniennes.
On revient à une surexploitation des fonds
Le nombre de langoustiers de Camaret et Douarnenez qui pêchaient sur le « Banc d'Arguin » était constant depuis une vingtaine d'années, ils sont dix bateaux, cinq camarétois et cinq douarnenistes. Ce nombre
Les filets ne sont pas sélectifs, ils capturent sans distinction les gros reproducteurs et les juvéniles, les langoustes capturées sont souvent blessées. De plus beaucoup de filets sont perdus dans ces fonds très accidentés, comme ils sont imputrescibles ils continuent à pêcher et à détruire les langoustes.
Beaucoup trop de monde pour une ressource qui a déjà montré sa fragilité à la fin des années 1960.
Les débarquements cumulés de Camaret et Douarnenez sont les suivants :
1986-87.............. 882 t - (Camaret + Douarnenez)
1987-88.............. 638 t - (Camaret + Douarnenez)
1988-89.............. 317 t - (Camaret + Douarnenez)
Les quantités débarquées dans les deux ports sont en forte baisse d'une année sur l'autre, ne présagent pas d'un avenir serein, les armateurs réagissent.
1989 – Les Douarnenistes arrêtent la pêche à la langouste rose
La société "France Langouste", qui possèdait cinq navires langoustiers, rachetés par P.Y. Delhemmes après la signature de l'accord CEE–Mauritanie en 1987, avait déjà désarmé le Joliot-Curie en 1988 pour cause de vétusté (il a ensuite servi de cible à la Marine Nationale qui l'a coulé).
En 1989, devant les problèmes posés par la cohabitation avec les Portugais, P.Y. Delhemmes vend encore le Rio-Del-Oro, puis l’Iroise, à la société franco-marocaine "Sud Langouste", qui pratique la pêche à la langouste verte. Puis, en aout 1989
il ne ne renouvelle pas les licences pour ses deux derniers langoustiers : Notre-Dame-de-Rocamadour et Claire-Jeanne.
À partir de cette date les cinq navires camarétois représentent la totalité de la flotte langoustière française.
Les camarétois résistent, puis renoncent
Contrairement à "France-Langouste" l'armement "Kuhn", ainsi que les armements du Castel-Dinn et du Portzic, renouvellent leur licence de pêche auprès des autorités mauritaniennes pour la campagne 1989-1990.
A la fin de l’été 1989 les cinq navires reprennent la route du Sud.
Malgré l'interdiction de la pêche au filet et les rappels de la CEE, la flotte portugaise demeure sur place et continue son pillage. La concurrence pour les zones de pêche est très forte. Les fileyeurs portugais déploient chacun jusqu'à 30 kilomètres de filets, sans être inquiétés par les autorités mauritaniennes qui ne prennent en compte ni le contenu des accords ni la gestion de la ressource. Ces filets couvrent les derniers retranchements des crustacés et capturent sans distinction reproducteurs et juvéniles. La langouste se raréfie.
Le Castel-Dinn et le Portzic, rentrés d'un premier voyage mi-décembre 1989 avec respectivement 10 et 8 tonnes de crustacés, hésitent à repartir. La disparition des langoustes et les conditions de travail face aux Portugais leur font craindre la fin du métier. Finalement, après un mois à Camaret, ils repartent mi-janvier 1990, convaincus qu'il s'agit de leur dernière campagne.
Fin janvier 1990, les trois langoustiers de l’armement Kuhn reviennent au port après quatre mois de mer et une pêche correspondant au tiers de celles des années précédentes à la même époque. Ils jugent le métier fini.
L'armement Kuhn décide d'arrêter la pêche à la langouste rose.
Au mois de février, le Castel-Dinn et le Portzic, à peine arrivés sur les lieux de pêche en Mauritanie, prennent la décision d'écourter leur campagne et rentrent au pays, pour eux aussi c'est la fin du métier.l
La fin d'une époque
Deux années de cohabitation désordonnée avec les Portugais auront suffi pour anéantir la langouste rose du Banc d’Arguin et mettre fin à une activité qui fait la renommée de Camaret et Douarnenez pendant plus de trente ans.
L’accord de 1987, pourtant porteur d’espoir, précipite le déclin de la pêche à la langouste rose. L’usage de moyens prohibés, l’absence de contrôles et la non-prise en compte de la gestion de la ressource, ont eu raison d'une espèce déjà fragilisée.
1990 - Une catastrophe économique pour Camaret.
Les cinq équipages, environ une cinquantaine d'hommes, se retrouvent sans travail. Si quelques-uns arrivent à l'âge de la retraite, d'autres doivent changer de métier et s’orientent vers la pêche au chalut dans divers ports finistériens, la petite pêche ou la marine de commerce.
La langouste rose représente 70 % de la valeur débarquée à Camaret et sa disparition a des conséquences sur les métiers liés à la mer. La construction et la réparation navale perdent une grande partie de leur activité, tout comme les mécaniciens, électriciens et frigoristes.
La Marée Camarétoise, créée en 1965, spécialisée dans le commerce des crustacés et disposant de 42 bassins de stockage à terre pour conserver les langoustes, cesse son activité dès mars 1990.
Que sont devenus les grands langoustiers










Sources
Presse: Le Marin, France pêche, La Pêche-Maritime, France-Ecopêche, Ouest-France, Le Télégramme.
Histoire de la pêche langoustière de Françoise Pencalet-Kerivel.
Archives des affaires maritimes
Nombreux témoignages oraux: Jo Palud, Bertrand Palud, Daniel Binet, Jos Drévillon, José Trétout, Jean-Yves Sévellec.